Category Archives: Les Fictions BiBi
avril 10, 2015
Bibi

Tant de fois où Elle baissait la voix jusqu’à en être inaudible. Je n’osais lui demander de répéter, sachant que ses phrases ne supporteraient pas la redite. Instants passés, effacés à jamais ; phrases perdues, révolues, disparues.
J’essayais pourtant de m’en souvenir, de rester concentré pour, plus tard, les inscrire une à une dans mes carnets. Je me rendais alors compte que, la plupart du temps, mes transcriptions étaient tronquées, approximatives. Je finissais par me dire qu’au fond peu importait cette infidélité car mon bouleversement, mon bonheur tenaient en grande partie des seuls instants où Elle les disait.
Elle parlait. J’écoutais. Elle se taisait.
J’enregistrais ses silences.
Son débit était toujours très lent, un pas devant l’autre, un mot après l’autre. Elle parlait, elle rêvait, elle marchait. Trois mouvements simultanés. Puis elle se taisait. Parfois, elle relançait ses mots à la volée, elle parlait au ciel sans s’arrêter sur ma présence. D’autres fois, elle marquait une courte halte, posait son regard intense sur moi et je revenais à nouveau dans le jeu.
J’ai appris à aimer ces va-et-vient, ces saccades, ce bain sonore où les idées ne comptaient plus, où le sens se perdait dans les sables, dans les fourrés, dans les forêts, dans le grand vent du grand large.
Et convaincu j’étais que la Terre toute entière, que la mer et les Océans nous chérissaient, nous remerciaient.
mars 12, 2015
Bibi
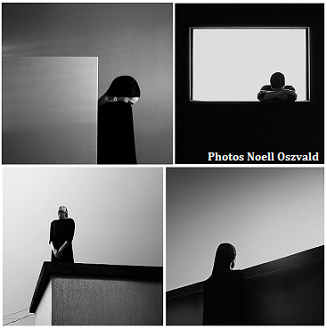
« Je ne sais plus ce que je dis ». C’est par ces mots déposés que notre quinzième rencontre a débutée. Non qu’Elle s’en vantait pour faire l’intéressante. Non qu’Elle commençait lucidement à délirer… Ce n’était pas non plus un constat froid, distancié. «Je ne sais plus ce que je dis» ajouta t-elle une seconde fois.
Et tout advint ensuite. Tout, entrecoupé de silences, de sourires (qui n’en étaient surement pas) : phrases lâchées dans les brumes, en plein soleil, sur les bords des grands fleuves ou en enjambant les ruisseaux des montagnes (ce jour-là, nous étions remontés aux sources). Il était naturellement hors de question d’en prendre note sur le vif. Je m’y étais résigné.
C’est donc sur des souvenirs brouillardeux que je les ai reconstruites et les ai retranscrites ici. Parfois, il me semble même que j’ai usurpé sa place d’énonciatrice. Honteux, je suis presque persuadé – à mon corps défendant – que tout cela vient de moi. Je pèse longuement le pour, longuement le contre. L’a-t-elle dit ? L’ai-je ainsi écoutée ? Je ne sais plus.
J’avoue alors que très souvent, trop souvent, fébrile à mon tour, je me surprends à murmurer, à me répéter : «Je ne sais plus, je ne sais plus ce que j’écris».
Au final, restent ces vingt fois. Les voici donc…
février 10, 2015
Bibi

Elle se demandait souvent comment les écrivains trouvaient le temps d’écrire. Quand elle sentait en elle le désir du Romanesque, elle n’avait pas toujours un crayon et du papier à portée de main et elle ne se précipitait pas pour aller en chercher. Cela ne la désolait pas car, au fond, ce qui l’intéressait n’était pas l’acte même d’écrire.
Ce qui la tenait et la retenait, c’était qu’elle aimait ressentir les premiers signes d’un bouleversement intérieur tout en continuant de rester active et immergée dans le réel. Il était difficile pour quiconque de percevoir son soudain état de possession intérieure, son agitation mentale où les mots affluaient à si grande vitesse.
janvier 25, 2015
Bibi
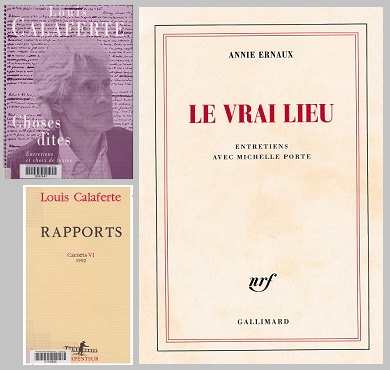
Lire. La lecture. Denrée quotidienne, package hebdomadaire. Dès le livre fini, pas de temps à perdre, il faut flairer, renifler l’odeur du prochain à lire. Un livre puis un autre : une maladie dont on ne guérit pas. Cette semaine, j’ai été malade-bien-portant avec Annie Ernaux et Louis Calaferte.
décembre 30, 2014
Bibi

*
J’aimais la voir marcher sur le sable fin de notre plage. Elle s’arrêtait devant moi, posait son sac de toile, en retirait livres, serviette, crème solaire (elle s’en enduisait le dessus des cuisses, l’entour du nombril, le bout du nez). Elle chantonnait bien sur, mais le plus souvent elle parlait, sans but, lançant à la cantonade des phrases qui semblaient voleter sur la crête des sables ou au-dessus des vagues.
J’entrepris de rassembler ses incises. Ce que j’avais perçu instantanément, c’est qu’elles allaient compter pour moi, que ses rares paroles par moi retenues seraient là, à mes côtés, de tous côtés, toute ma vie durant.
Parfois Elle s’éloignait. Elle me laissait seul, rejoignant les membres d’une équipe de volley pour d’interminables parties. J’en profitais pour ouvrir un petit carnet que j’avais acheté au Grand Bazar et tentais de consigner au plus près ses petites proses. Bercé par le flux et le reflux, j’oubliais les hourrah des volleyeurs, les pleurs d’enfants pourtant tout proches (je t’avais dit, disait la mère, de ne pas t’éloigner, les vagues sont hautes et le roulis t’a fouetté si fort, si fort qu’il t’a fait tomber, t’as vu hein) et je noircissais consciencieusement les pages de mon livret…
Ces phrases, jadis disséminées par les vents, me reviennent aujourd’hui pleine face, toujours difficilement explicables, toujours tournoyantes mais si précises, si indispensables. Elles m’arrivent par pelletées entières ; je les retrouve, je les (re)découvre aussi, immergé dès lors dans d’interminables travaux de copiste.



